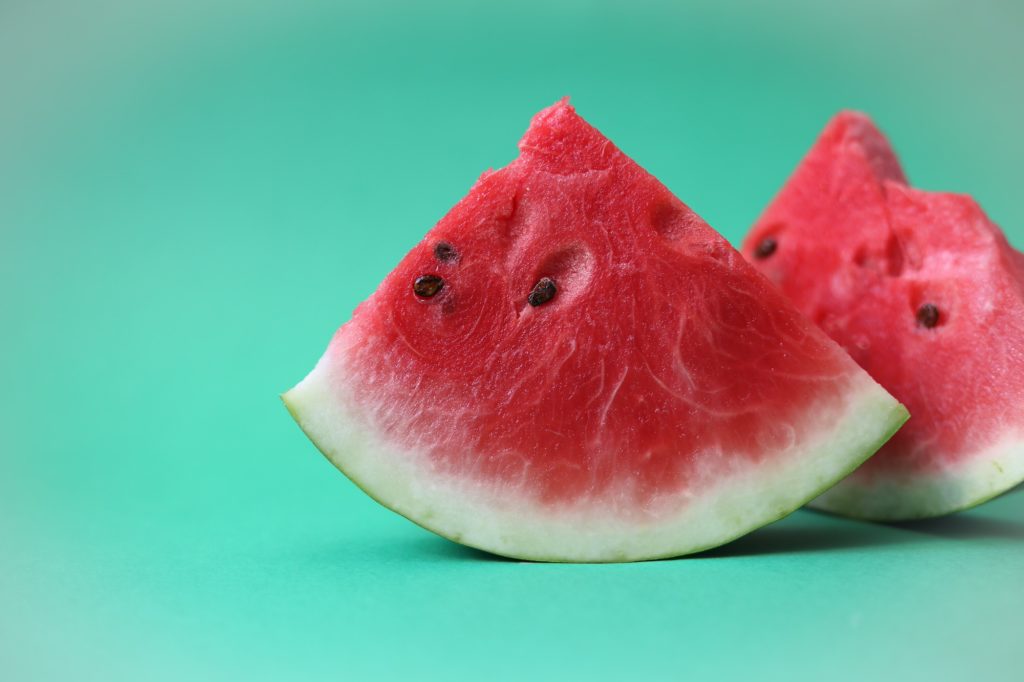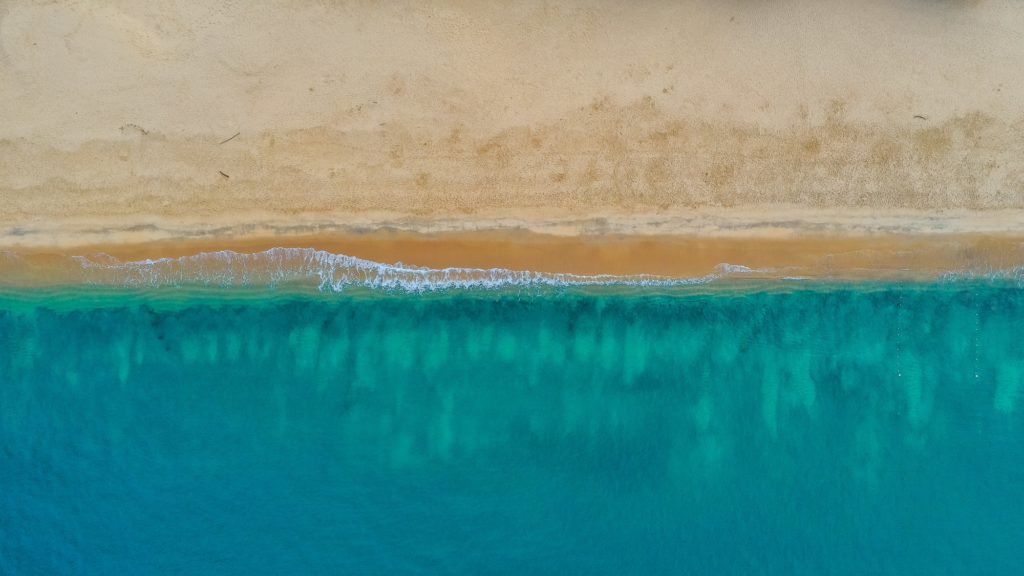
« À qui appartient la mer ? » est une question que nous nous posons souvent et qui semble ne pas avoir de réponse simple. En réalité, le droit de la mer est réglementé depuis 1982 par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). Analysons ensemble pour mieux comprendre si la mer appartient à tout le monde, à personne ou à l’État.
Le droit de la mer régit les relations entre les États en ce qui concerne l’utilisation de la mer. En raison de sa complexité, de son caractère interdisciplinaire et de son évolution constante, le droit de la mer est extrêmement dynamique et doit s’adapter aux nouveaux défis. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, nous assistons à des négociations pour protéger et réglementer l’utilisation des ressources marines. Un exemple en est les négociations qui se sont tenues à New York en août 2022 pour adopter le Traité sur la haute mer.
Bien que nous ayons tous accès à la mer, il existe une division en différentes zones, allant de la liberté totale à la souveraineté complète de l’État côtier. Chaque zone est caractérisée par une limite définie en milles marins à partir de la côte et est soumise à différents obligations, lois et règles. Comme le montre l’image ci-dessous, les principales zones sont au nombre de cinq : mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive (ZEE), haute mer et aire.

Mer territoriale
Bande de mer adjacente aux côtes de l’État. La limite maximale d’extension est de 12 milles marins, mesurée à partir d’une ligne de base.
Zone contiguë
S’étend sur 12 milles marins supplémentaires au-delà de la mer territoriale. L’État côtier y exerce son autorité afin de prévenir ou de réprimer les infractions à sa législation nationale.
Zone économique exclusive (ZEE)
Si elle est déclarée et approuvée, elle s’étend jusqu’à 200 milles marins des côtes. Elle sert de zone de transition entre la souveraineté complète et la liberté totale.
Haute mer
Le principe de la liberté des mers s’applique ici, à condition de respecter les intérêts des autres États.
Zone
Les fonds marins et océaniques, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale telles que définies dans la présente Convention, sont considérés comme le patrimoine commun de l’humanité.
L’histoire du droit de la mer
Le premier essai de régulation de la souveraineté des eaux remonte à 1493 avec la bulle papale « Inter cætera » d’Alexandre VI. En 1492, Christophe Colomb avait découvert l’Amérique, pensant atteindre l’Inde en naviguant vers le sud, à la latitude des Canaries. Pour son retour en Europe, il avait préféré naviguer à la latitude des Açores. À son retour, le pape traça une ligne reliant le pôle Nord au pôle Sud, à environ 100 lieues (environ 482 kilomètres) des Açores. Toutes les terres situées à l’ouest de cette ligne étaient attribuées à l’Espagne.
Le Portugal ne fut pas satisfait de cette donation. Étant également une nation chrétienne et maritime, il négocia. À Tordesillas, en Espagne, fut ainsi signé le Traité de Tordesillas qui fixa le méridien de Tordesillas à environ 370 lieues (environ 1786 kilomètres) des îles du Cap-Vert. L’Espagne et le Portugal s’accordèrent pour que toutes les terres à l’ouest de cette ligne appartiennent à l’Espagne et celles à l’est au Portugal. C’est pourquoi le Brésil parle encore portugais aujourd’hui.
En 1529, avec le Traité de Saragosse, les États commencèrent à revendiquer la propriété des zones maritimes, interdisant aux autres nations de naviguer ou d’exercer toute activité dans ces zones sans autorisation de l’Espagne ou du Portugal.
D’autres États comme les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France refusèrent d’accepter cette division des eaux entre l’Espagne et le Portugal. Pour eux, le pape n’avait pas l’autorité politique de donner des terres ou des mers à qui que ce soit.
La mer est-elle libre ?
En 1609, Hugo Grotius, philosophe, théologien, juriste et homme politique néerlandais, défendit le droit de son pays à naviguer et à commercer en mer dans son ouvrage « Mare Liberum », ouvrant ainsi un nouveau débat sur la liberté des mers. Selon Grotius, il est impossible aux États d’imposer leur souveraineté sur l’eau. L’eau est un élément libre et personne ne peut en interdire l’usage.
La même année, en Angleterre, le roi Jacques Ier promulgua une loi visant à limiter la pêche dans les eaux côtières britanniques. Cette loi interdisait à tout étranger de pêcher le long des côtes des îles britanniques afin d’éviter la surpêche. La limite de cette loi résidait dans le fait qu’il n’était pas clairement défini jusqu’où s’étendaient les eaux anglaises.
La première division des mers
Pour la première fois, les États pouvaient exercer leur souveraineté uniquement à proximité des côtes, dans les eaux territoriales. Au-delà de cette limite se trouvait la haute mer, libre à tous. Mais comment a-t-on établi la limite des eaux territoriales ?
Le juriste néerlandais Cornelis van Bynkershoek, dans son ouvrage de 1702 « De dominio maris », théorisa la « règle de la portée du canon », identifiant la limite à la portée maximale d’un tir de canon. Le problème était que la portée des canons augmentant avec le temps, cette mesure n’était pas fixe et dépendait des avancées technologiques de chaque État.
Le juriste italien Ferdinando Galliani, dans son ouvrage « Droit de la mer en temps de guerre », proposa d’établir une distance fixe, de 3 milles marins (environ 5,5 kilomètres) à partir des côtes, afin d’éviter les disputes. Cette théorie fut ensuite adoptée par les principales puissances maritimes comme les États-Unis et la Grande-Bretagne.
L’évolution du droit de la mer au XXe siècle
Le XXe siècle a marqué un tournant pour le droit de la mer. Au cours de ce siècle, tous les usages traditionnels des mers et des ressources marines ont été abordés et réglementés par des normes de codification internationale. Par le passé, les lois maritimes n’étaient pas écrites et codifiées, mais régies par des règles coutumières difficiles à contrôler.
En 1930, la Société des Nations tenta pour la première fois de codifier le droit de la mer, sans toutefois y parvenir complètement.
La seconde tentative fut menée par les Nations Unies en 1958 et 1960 avec la Convention de Genève. Là encore, le cadre juridique élaboré ne fut pas un succès total, mais les négociations se concentrèrent sur des questions spécifiques, comme la haute mer.
Ce n’est qu’en 1973 que les Nations Unies parvinrent à trouver une méthode de travail et de négociation permettant d’élaborer à l’échelle mondiale la Convention sur le droit de la mer.
Qu’est-ce que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ?
En 1973, les Nations Unies sont parvenues à codifier le droit de la mer à travers la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). La Convention a été adoptée en 1982 à Montego Bay, en Jamaïque.
La Convention a nécessité un certain nombre de rectifications, c’est pourquoi elle n’est entrée en vigueur qu’en 1994, après avoir été approuvée par tous les participants. Pour modifier le texte final, il faudrait rouvrir les négociations.
- L’universalité des participants : les négociations étaient ouvertes à tous les États membres des Nations Unies, à l’Agence internationale de l’énergie atomique, à la Cour internationale de Justice, à des organisations intergouvernementales, à des mouvements de libération nationale et à bien d’autres entités. Il s’agissait d’une conférence universelle garantissant la légitimité du processus de négociation.
- La durée des négociations a été très longue : dix ans ont été nécessaires pour achever les travaux (1982) et seize ans pour que les États, les observateurs et les acteurs de la communauté internationale produisent la Convention finale (1994).
- Il s’agissait d’adopter une convention traitant de toutes les questions relatives à la mer. La Convention finale est un document très complet, surnommé la « Constitution des océans », dont la portée géographique est immense, l’océan couvrant plus de 70 % de la surface de la Terre.
Comment mesure-t-on la ligne de base ?
La ligne de base, baseline en anglais, correspond au point de départ pour mesurer la distance à partir de la côte afin de déterminer les limites des différentes zones maritimes. L’article 5 de la Convention établit la règle générale pour définir et tracer cette ligne.
La ligne de base pour mesurer l’étendue de la mer territoriale est généralement la ligne de basse mer le long de la côte, telle qu’indiquée sur les cartes marines officiellement reconnues par l’État côtier. Cependant, des variations peuvent s’appliquer en fonction de la configuration géographique de la côte, de considérations historiques ou économiques.
Quelques exemples d’exceptions à la règle générale :
- Côtes très découpées: Lorsque la côte est très découpée, avec de nombreuses îles proches, les lignes de base suivent les points les plus extérieurs de la côte. C’est le cas par exemple en Norvège et en Croatie.
- Baies historiques: Le golfe de Tarente, par exemple, est considéré comme faisant partie des eaux territoriales italiennes.
- Deltas de fleuves très découpés: Comme en Bangladesh et au Myanmar.
- Eaux polaires: Les banquises flottantes peuvent modifier la ligne de côte.
- États archipélagiques: Composés de nombreuses îles.
À partir de cette ligne de base, on mesure la distance pour toutes les autres zones définies par la Convention.
Bibliographie :
- https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- https://www.geopolitica.info/mare-relazioni-internazionali-parte3/
- https://www.imo.org/en/OurWork/Legal/Pages/UnitedNationsConventionOnTheLawOfTheSea.aspx